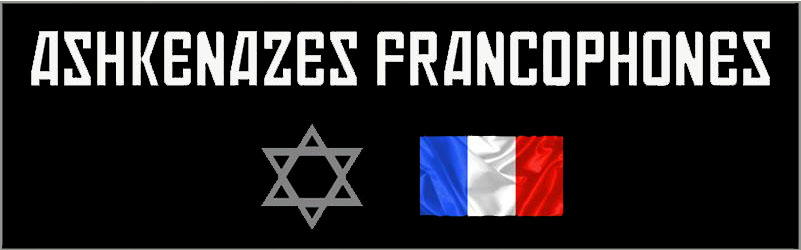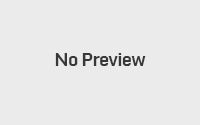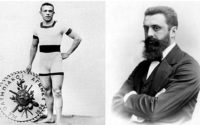« Juifs sans frontières, identité sans repos »
Extrait de « Estimable rédacteur en chef »
Isaac Metzker
Pourquoi cette prédilection des immigrés juifs en France, en Amérique, pour les métiers du vêtement ? La raison n’en est certes pas à rechercher dans les textes de la Torah. Aucune corrélation fatale entre les Juifs et les shmattès. Ils ne savaient faire que ça, avancera-t-on. Mais posons plutôt la question autrement. Pourquoi un Juif communiste ou sympathisant, croyant dur comme fer aux vertus rédemptrices du prolétariat, ne cherchait-il jamais à se faire embaucher aux usines Renault à Billancourt ou chez Chrysler à Detroit, Michigan, pour devenir un ouvrier comme un autre, inséré dans la production industrielle et devenant un militant « sans patrie ni frontière », en véritable internationaliste ?
Certainement pas par incompétence, mais, justement, parce qu’alors il pressentait obscurément qu’il cesserait d’être juif. Ces immigrés-là, tout internationalistes qu’ils fussent, et malgré toute leur prétendue soif d’intégration, voire pour certains d’assimilation, n’entendaient pour rien au monde cesser d’être juifs. En entrant dans l’industrie — métallurgique, automobile, minière — ils resteraient certes les ouvriers qu’ils pensaient être, en quoi ils se définissaient économiquement, mais ils y auraient perdu peu ou prou une part essentielle de leur identité.
Si leur but, comme travailleurs exploités, était bien que le monde un jour connaisse enfin la justice, que les patrons reculent sur leurs prérogatives de classe, ils caressaient aussi, chevillé au corps, l’espoir de s’en sortir, de devenir patrons à leur tour, d’ouvrir un magasin où ils seraient maîtres chez eux, où ils donneraient les cartes. Attitude très peu « communiste », on en conviendra, mais juive assurément. La réussite des Juifs aux États-Unis n’a pas d’autre explication. Les valeurs socioculturelles de ce pays et l’idiosyncrasie juive étaient faites pour s’accorder.
Aujourd’hui, deuxième, troisième, quatrième générations de ces immigrés juifs sont parfaitement intégrées. Si leur amour de la France ne souffre en général pas d’exception — la France de Voltaire, de Hugo, de Zola et de Jaurès, et non celle de Barrès, de Maurras, de Pétain et de Le Pen — il est parfois des soubresauts ici même ou à l’échelle du monde qui ont tendance à les désassimiler. Leurs prédécesseurs « israélites » comtadins, bordelais ou alsaciens-lorrains avaient connu, eux aussi, de l’affaire Dreyfus au régime de Vichy, de telles oscillations identitaires, passant tour à tour de l’assimilation à l’affirmation juive de soi. (Les Réflexions sur la question juive de Sartre, de 1946, vaudraient surtout pour ces Juifs-là, du capitaine Dreyfus à Pierre Mendès France.)
Vient alors en avant le sentiment de leur judéité, de leur singularité irréductible (chez eux, la judéité comme culture s’est depuis longtemps substituée au judaïsme comme doctrine religieuse).
Que leur reste-t-il de la yiddishkeit de leurs aïeux ? Peu de chose : des bribes de chansons yiddish, un goût maintenu pour les plats juifs d’Europe centrale et orientale, quelques histoires juives et quelques mots de yiddish, clin d’œil et mots de passe à usage interne. Et la mémoire ineffaçable du génocide. Leurs convictions de gauche se sont parfois émoussées, nul n’est parfait. De même que les anciens clivages qui semblaient jadis indépassables, faits de suspicion, d’hostilité indomptable entre sionistes, communistes, religieux, bundistes…
La situation au Moyen-Orient, depuis la guerre des Six Jours de 1967, l’antisémitisme qui affleure parfois ont rassemblé tout ce petit monde. La visibilité de ces ashkénazes est aujourd’hui moindre que par le passé. Ils n’habitent plus les mêmes quartiers, fréquentent toujours aussi peu les synagogues et les écoles juives, ne parlent plus le yiddish, même si certains l’apprennent ou le réapprennent. Les idéologies ont moins prise sur eux. Si certains ont vécu en Israël (dans les kibboutzim de gauche), traversé le gauchisme en France (version Trotski ou Mao), ils en sont revenus. Leur identité juive est cependant intacte. Ils la cultivent sur un mode laïc. Les menaces qui pèsent sur l’État d’Israël, que d’aucuns, comme naguère pour les Juifs, voudraient voir effacé du monde, les soudent encore, et sans doute pour longtemps.
Henri Raczymow