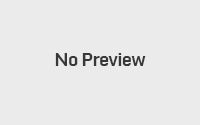L’antisémitisme, ses origines et ses modes d’expression
On m’a dit, on me dit toujours, et on me dira sans doute encore pourquoi s’occuper, aujourd’hui, de l’antisémitisme contemporain ? En cette époque si lisse ou les juifs jouissent d’une relative tranquillité, et ou les violences et les persécutions sont loin d’égaler, en intensité comme en étendue, celles du passé, proche et lointain ?
Je réponds donc : pour cela même.
C’est justement parce que l’antisémitisme de nos jours prends la forme plus vicieuse et retorse que ces tenants prêtent aux juifs que le combat idéologique est primordial. Autrement, en des temps plus difficiles et plus massivement criminels, les armes de la critique ne peuvent que laisser place aux armes tout court, à la contre-violence comme stratégie de survie. Ainsi en de pareilles circonstances, dont est si friande l’histoire d’Israël, ces questions perdraient naturellement tout leur sens devant l’évidence de la tragédie et la nécessité de la résistance, au sein de laquelle la production littéraire critique ne joue qu’un rôle secondaire. C’est donc parce que nous sommes en mesure de mener une lutte idéologique contre l’antisémitisme, et que nous jugeons que celle-ci représente l’aspect principal de de cette lutte, que nous nous y appliquons.
Aussi, l’antisémitisme contemporain ayant pour principal cheval de Troyes d’invisibiliser les mécanismes antisémites en se référant comparativement à l’extrême brutalité passée de celui-ci ou encore à d’autres formes de racismes jugés plus préoccupants, en parler et dévoiler la supercherie revient à faire acte de salubrité publique.
Enfin, les meurtres antisémites de Sébastien Sélam, Mireil Knoll, Ilan Halimi et autres fils et filles de la communauté juive, bien qu’ils ne soient jamais que les conséquences les plus paroxystiques d’un antisémitisme structurel, nous empêchent d’éluder la question d’un revers de main.
Ces éclaircissements apportés, nous pouvons maintenant nous pencher sur les origines de l’antisémitisme contemporain ainsi que ses principaux modes d’exercice, les principaux schémas de pensée qui y préside.
Pour se faire, nous tenterons, dans ce qui suit, de classifier schématiquement les principaux affluents dont se nourrit l’antisémitisme contemporain, qui a pour principale caractéristique sinon de les marier, au moins de les faire cohabiter « harmonieusement ».
1) L’antisémitisme ecclésiastique plurimillénaire décadent
On ne peut évidemment pas présenter un panorama de l’antisémitisme européen sans nous référer à ce qui constitue sans doute sa racine super-structurale première : l’antisémitisme ecclésiastique qui se fonde sur l’accusation de « peuple déicide » (accusation portée par l’Eglise chrétienne contre les juifs d’avoir assassiner le Christ), ce à quoi s’ajoute corrélativement celle de « peuple récalcitrant » car opposant son refus au message christique salvateur.
Ces deux thèmes fondateurs de l’antisémitisme chrétien, s’ils ont longtemps pu servir à détourner, dans une logique de désignation de boucs émissaires, la colère populaire des populations plébéiennes chrétiennes contre le pouvoir en place en pogroms visant les juifs alors désignés comme figures diaboliques et par conséquent responsables de tous les maux terrestres, ne prennent, dans le discours antisémite contemporain, qu’une propension minime et tout compte fait quasi-négligeable.
Les sociétés européennes contemporaines anciennement sous la coupe du pouvoir ecclésiastique ayant subi, sous l’impulsion du siècle des lumières et des réformes religieuses successives, une forte déchristianisation, ce type d’antisémitisme inextricablement lié au poids de l’Eglise dans la société n’est plus à l’ordre du jour, sinon dans les quelques milieux conservateurs fortement liés aux préceptes religieux chrétiens dans leur acceptation la plus littéraliste et réactionnaire.
Toutefois, si cet antisémitisme anachronique pu être socialement décimer par le mouvement progressiste de l’Histoire (le passage d’un mode de production féodal à un mode de production capitaliste induisant une libéralisation générale des mœurs et un adoucissement de l’emprise théocratique sur le pouvoir politique), il n’en demeure pas moins que celui-ci, dans une logique de rupture-continuité, se transmua en antisémitisme moderne qui, tout en reprenant les principaux stéréotypes dont l’Eglise affuble les hébreux, en fit un usage laïcisé.
De ce fait, bien que ses fondements théologiques se soient ébranlés, l’antisémitisme européen, tenace du fait de son enracinement profond dans l’imaginaire collectif des peuples d’Europe ( imaginaire largement structuré – même sous des formes laïcisées- par l’Eglise chrétienne, comme le démontre magistralement Emmanuel Todd en recourant au concept de « catholicisme zombie » pour expliquer à la fois la montée en puissance de l’islamophobie et la persistance de l’antisémitisme en France), continue de s’imposer comme idéologie étatique et comme fausse conscience populaire. (« L’antisémitisme est l’anticapitalisme de l’imbécile » écrit très justement Bebel)
2) L’antisémitisme moderne : du sacré au profane et de l’Eglise à l’Etat
Comme nous l’avons affirmé plus haut, les sociétés européennes accédant à la modernité marquant l’essor du capitalisme concurrentiel et, subséquemment, l’apparition de la forme juridico-politique qui lui est reliée (L’Etat-nation) ; l’antisémitisme propre à cette époque prit à son tour des formes nouvelles qui consistent à la fois en une perpétuation et un dépassement de l’antisémitisme prémoderne portant le sceau de la chrétienté.
L’antisémitisme moderne quant à lui s’exercera sous l’égide de l’Etat-nation tenant lieu d’Eglise nouvelle, sans pour autant rompre avec l’Eglise traditionnelle qui sut se maintenir contre vents et marrées, par moults concessions, comme agent politique déterminant tout au long de l’époque moderne et, à certains égards, encore de nos jours dans plusieurs régions du monde, y compris en Europe de l’Ouest.
Tentant d’apporter des pistes de réflexion à ce phénomène séculaire de type nouveau sans pour autant prétendre à épuiser le sujet, nous proposons ci-après de poser les jalons de ce qui en constitue les principaux aspects.
a)L’éjection du juif du corps national ou le juif comme figure de l’ennemi intérieur
L’époque moderne étant celle de l’émergence de l’Etat-nation en tant que reflet super-structurale de la modification progressive des rapports de productions aboutissant au capitalisme, la délimitation d’une « communauté nationale » nécessaire au développement du capitalisme ascendant se faisait essentiellement sur des bases ethnico-religieuses et culturelles dont les juifs étaient par conséquent de facto plus ou moins ouvertement exclus. Précisons notre propos : en réalité, comme ce fut le cas lors de la période médiévale prémoderne en Europe, les juifs étaient assignés à une double position répondant à une double volonté étatique tendant à la fois à les exclure du domaine de la Nation, les désignant comme « Autres » et fondamentalement « inassimilables » tout en les gardant dans une relative proximité vis-à-vis de la société – le plus souvent à la marge, tant d’un point de vue spatial que socio-politique. Inutile de dire que cette manœuvre a pour principal objectif de masquer les contradictions de classes au sein de la formation sociale en devenir et d’y substituer une « union nationale » dont la figure du Juif – foncièrement « cosmopolite » et « nomade »- sert de catalyseur et cimente les partis constitutifs du « corps national » face à ce qui, à grand renfort de propagande exploitant le plus souvent la religiosité et le chauvinisme des populations nationales, se présente comme une menace interne susceptible d’ébranler les fondements de la nation. (De là le mythe du « complot juif international »). En tous les cas, le Juif est perçu comme « Etranger » ; non pas comme ressortissant d’une nation autre, mais comme idéal-type du « Vagabond », c’est-à-dire de « sans Etat » amener, par la force des choses et à son corps défendant, à s’y confronter. Cette thématique du juif « ennemi d’Etat » – comme il fut auparavant « ennemi de l’Eglise » – constitue l’aspect principal du phénomène antisémite moderne, comme en attestent les envolées lyriques d’un Dostoïevski pour qui les juifs forment « un Etat dans l’Etat » avec « organisation » et « particularisme » dont la « petitesse » fait « la preuve de leur faillite morale irrémédiable, d’une banqueroute humaine totale » ; ou encore plus explicitement Proudhon qui affirme qu’ils sont « Une franc-maçonnerie à travers l’Europe, une race incapable de former un Etat, ingouvernable par elle-même, s’entend merveilleusement à exploiter les autres. Son analogue dans les Bohémiens, les Polonais émigrés, les Grecs et tout ce qui vagabonde ». Synthèse de ce florilège : le Juif est exclu pour sa méconnaissance absolue du sens de l’Etat, son refus pratique du concept. A l’évidence, l’Etat-nation moderne ne pouvant tolérer une existence supranationale et déterritorialisée semblable à celle du peuple juif, il désigna tout bonnement ce dernier comme ennemi absolu dont l’élimination – y compris par l’éradication physique, dont la « solution finale » hitlérienne est l’aboutissement et le déroulement ultime de la logique portée à une échelle planétaire- est en quelque sorte nécessaire à l’affirmation du triomphe de la puissance étatique sur les formes communautaires qui la nient par leur existence même, par leur essence fondamentalement « antiétatique ». (Ainsi en est-t-il du mythe du « complot judéo-bolchévique » par lequel on fait du juif l’agent et l’instigateur d’une idéologie fondamentalement planétaire et internationaliste et qui, par conséquent, ne peut relever que de la « juiverie internationale »)
b) assimilation du « caractère juif » aux caractéristiques propres à l’argent ou le juif comme figure honnie du capitalisme
Une autre des discriminations antisémite dont souffrent le plus fréquemment les juifs dans le cadre d’une société régie par un mode de production capitaliste est celle consistant, -pour des raisons relevant du rôle prépondérant des juifs dans le développement capitaliste européen du fait de leur pratique forcée de l’usure et du « travail de l’argent » ; les autres professions leur étant refusées par le pouvoir ecclésiastique- à conférer aux juifs des caractéristiques propres à l’argent et au pouvoir qu’il confère : sens de l’abstraction, mobilité accrue, universalisme, sournoiserie et fourberie. Cette assimilation du juif à l’argent procède non seulement d’une survivance de la période médiévale, mais aussi principalement d’une critique biaisée du capitalisme réduit à son pendant financier-bancaire – la figure du juif coïncidant le plus souvent, dans l’imaginaire antisémite, avec celle du banquier. De cette façon, l’idéologie dominante, qui est aussi celle de l’extrême-gauche du capital, aboutit une fois de plus à un détournement de la critique du capitalisme global en une critique parcellaire et inoffensive de la finance et du « pouvoir de l’argent » incarné par le baron de Rothschild. Résultat : la bourgeoisie dominante, manœuvrant l’antisémitisme latent des masses populaires, maintien son pouvoir en substituant le « Juif » au capitaliste et la dictature de la bourgeoisie en « pouvoir juif mondial ». Les conséquences les plus désastreuses et catastrophiques de ce type de discours avancés par la bourgeoisie aux abois qui en fait une de ses principales armes idéologiques lors des moments de grandes offensives prolétariennes justifiant son passage au fascisme – qui n’est jamais que « la dictature terroriste ouverte des éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins, les plus impérialistes du capital financier » ( Dimitrov) ; le capitalisme financier n’étant pas présenté, dans ce sens, comme « fondamentalement juif » ou « sous influence juive » , mais comme fusion du capital bancaire et du capital industriel servant de base matérielle à l’avènement et au développement du fascisme – sont sans nul doute ceux produites par le fascisme allemand que le même Dimitrov décrit en ces termes : « Le fascisme allemand ce n’est pas seulement un nationalisme bourgeois, c’est un chauvinisme bestial. C’est un système gouvernemental de banditisme politique, un système de provocation et de tortures à l’égard de la classe ouvrière et des éléments révolutionnaires de la paysannerie, de la petite bourgeoisie et des intellectuels. C’est la barbarie médiévale et la sauvagerie. C’est une agression effrénée à l’égard des autres peuples et des autres pays ». Paradoxe et ironie de la chose : pour prendre possession du pouvoir étatique, le capital financier « réel » leurre les masses en agitant le drapeau d’une fantasmatique « finance juive » aux contours flous et extensibles à souhait.
Il n’est cependant pas juste de prétendre que seule la bourgeoisie fasciste use de tels biais idéologiques : de manière moins explicite, des pans entiers de la gauche radicale y sont poreux.
Par pur calcul tacticien ou par collusion idéologique, nombre d’organisations de gauche cèdent aux maléfiques sirènes de l’antisémitisme populiste qui ne fait, in fine, que le lit de l’extrême-droite ; l’originale étant toujours préférée à la copie.
Pour tenter d’expliquer cette porosité apriori insoupçonnable à l’extrême-gauche de l’échiquier politique, Moishe Postone s’exprime en ces mots : « L’antisémitisme est une critique primitive du monde, de la modernité capitaliste. Si je le considère comme particulièrement dangereux pour la gauche, c’est précisément parce que l’antisémitisme possède une dimension pseudo-émancipatrice que les autres racismes n’ont que rarement ».
C’est donc en quelque sorte par confusion – et par confusionnisme entretenu en bien des cas- que la gauche et l’extrême-gauche se retrouvent à cautionner, sinon à alimenter, les pires discours, attitudes et comportements antisémites ; a fortiori si ceux-ci proviennent de ce qu’elles désignent comme « classes populaires » ou « minorités opprimées » (appellation refusée contre tout bon sens, en théorie comme en pratique, à la minorité juive). C’est parce que l’antisémitisme a de tout temps contenu en lui une part de révolte primitive et déformée contre « les gens de la haute » qu’il récolte les faveurs de nombreuses franges de l’extrême-gauche européenne.
c) le juif comme énergie Dyonésienne dans l’univers d’Appolon
Comme le décrit Georges-Arthur Goldschmidt dans le cas de l’Allemagne moderne, le juif tient la place de « témoin oculaire » de ce qui, aux yeux de la morale victorienne des sociétés de l’époque, est du registre du « décadent » : libéralisation des mœurs, décloisonnement national, développement de la science induisant une déchristianisation de masse, éclatement des tabous sexuels … etc
En somme, sur le modèle sartrien, le juif constitue cet « Autre » omniprésent et vecteur de honte. Dans ce rôle, il est à la fois l’instigateur et le témoin narquois de la « perdition » des sociétés occidentales. A la fois « corrupteur de la jeunesse » (et de ce fait apte, dans un schéma socratique, à se faire juger par l’assemblée des tenants de l’ordre ancien) et « témoin du drame » occidental.
En un sens, le juif cristallise malgré lui le non-dit des sociétés occidentales modernes, au point ou sa seule présence – qui laisse en elle-même présager une possible différence, voir un antagonisme latent- menace ce qu’il est commun de définir comme étant un « socle de valeurs » occidental commun présupposant une relative homogénéité qui se trouve être niée par la radicale différence du juif ; prélude à l’éclatement des différences sous-jacente au sein de la communauté nationale-occidentale.
Par ce fait, le juif devient, une fois de plus dans l’imaginaire antisémite moderne, l’agent du désordre, de la discorde ; celui dont le refus de l’assimilation prépare toutes celles à venir , ouvre la voie à toutes les dérives, c’est-à-dire à la fragmentation de la société, à la sape de ses fondamentaux sous le poids du jaillissement des contradictions – parfois antagoniques- longtemps occultées par l’idéologie étatique moderne tendant, jusqu’à un certain seuil de tolérance, à masquer les différences dans le but d’assurer sa domination symbolique. Passé ce seuil de tolérance, l’Etat entre dans un rapport de conflictualité extrême avec les groupes inaptes à se faire digérer par lui : ainsi en est-t-il, en Europe, des persécutions dirigées contre juifs et tsiganes ; ces peuples frères que la barbarie occidentale a fait au sens fort du mot des « frères de sang », des camarades de galère, des figures socratiques dont il ne faut point suivre les pas : de mauvais exemples dont la punition se doit de jouer un rôle cathartique, d’affirmer la puissance étatique majoritaire ( politiquement ) et de dissuader les potentiels dissidents tentés par la revendication d’un quelconque « droit à la différence » que l’Etat moderne ne saurait tolérer – sinon dans une infime mesure et de façon détournée.
Cette dynamique à l’œuvre atteindra son apogée dans l’expérience concentrationnaire et exterminatrice du régime nazie.
3) L’antisémitisme contemporain : de l’après- Auschwitz à la post-modernité
S’il est indubitablement juste qu’Auschwitz fut l’ultime accomplissement de la fureur antisémite moderne, il n’en demeure pas moins que celle-ci ne disparut pas avec la fin de la seconde guerre mondiale et la défaite du troisième Reich et de ses alliés.
Bien au contraire, le fond antisémite occidental persistant, l’épisode nazi ne fit que remodeler la forme de l’antisémitisme contemporain (post-1945). Certes, pour des raisons liées à la pacification européenne et le déplacement de l’arène des boucheries impérialistes en dehors des frontières du vieux continent combinées à l’absence de facteurs objectifs susceptibles de ressusciter le fascisme, jamais la violence antisémite ne put atteindre celle des camps de la mort ; mais il n’en reste pas moins, – nous l’avons souligner plus haut-, qu’une fois de plus, tout en sauvegardant certains traits des périodes précédentes, l’antisémitisme contemporain se pare de masques nouveaux, plus en phase avec la donne idéologique de l’époque post-moderne.
Ainsi la négation des chambres à gaz, la banalisation des crimes nazies au nom d’un relativisme absolu, la relativisation de l’holocauste juif, le grossier amalgame entretenu entre sionisme et nazisme… ; confinent tous à ceci : le refus du statut survalorisé de victime pour le peuple juif.
En effet, dans un monde ou la souffrance est -du moins en verbe- placée comme suprême vertu, la reconnaissance de cette dernière est refusée aussitôt qu’elle est accordée aux juifs sous couvert qu’après avoir été victimes, usant abusivement de leur statut, ceux-ci se transformèrent en bourreaux et en suppôts du « pouvoir blanc ».
Gravité de cette double-imposture : le juif – dont les sévices subis sont paradoxalement retenus comme étalon de la souffrance ; bien que souvent banalisés au nom d’une égalisation des supplices dans une logique de concurrence victimaire fondamentalement irrationnelle car n’ayant cure d’une quelconque objectivité factuelle et reposant entièrement sur le ressenti subjectif- est une fois de plus repeint en tortionnaire au nom d’une prétendue solidarité viscérale des juifs vis-à-vis de l’Etat israélien et de son gouvernement ( mélange du « juif cosmopolite » agent d’une puissance étrangère et du « juif communautariste » solidaire de « son » Etat) mais aussi , dans une inversion et une dérive du sens, il est rendu complice de ceux qui le persécutèrent de tout temps ( ici la carte du « privilège juif » dont les pouvoirs en place usent pour horizontaliser les luttes et faire gicler le feu des contradictions intercommunautaires ; l’exemple le plus connu étant celui de l’obtention sur demande de la nationalité française aux juifs d’Algérie par le décret Crémieux dans le but d’opposer la minorité juive à la majorité musulmane – opposition qui ne profite, en dernière instance, qu’au pouvoir colonial français. )
De cette façon, le juif recouvre séculairement son statut religieux de figure diabolique ; à croire qu’il est du destin d’Israël de subir les foudres d’Edom avec, cerise sur le gâteau, l’accusation d’en tirer profit (ce qui revient indirectement à légitimer le sort tragique réservé au peuple juif)
En pratique, cette haine antijuive, qui se traduit par une différence de traitement dés lors qu’il s’agit de questions approchant de prés ou de loin le « problème juif », peut-être aisément repérée dans nombre de positions et d’attitudes politiques- non-exhaustives- quotidiennement exprimées :
- L’antisionisme comme faux-nez de l’antisémitisme : cette question attisant toutes les passions, nous précisons d’emblée que toute critique de l’Etat d’Israël n’est pas, en soi, un acte antisémite. Cela dit, la patente démesure entre le poids politico-économique et géostratégique réel d’Israël et le déchainement médiatique et populaire de l’opinion internationale à son encontre ne demande qu’à être questionnée. J’avancerai donc d’entrée cette sulfureuse hypothèse : Israël constitue, dans l’imaginaire collectif, le juif parmi les nations. Ainsi, une évidente indignation à géométrie variable est à l’œuvre : une surréaction lorsqu’il convient de condamner les politiques guerrières et expansionnistes de l’armée israélienne et un silence complice lorsqu’il s’agit des agissements de tout autre colonialisme , tant est si bien que l’impérialisme français, dont le poids militaire, économique et politique est d’une envergure autrement supérieure, semble échapper aux critiques de ceux-là même qui s’évertuent à pointer du doigt toute nouvelle plantation coloniale israélienne sur le sol palestinien ; contrevenant totalement à un des principes fondamentaux de l’internationalisme prolétarien : la dénonciation première de sa bourgeoisie impérialiste propre.
- Symétriquement et dans la même pernicieuse logique différencialiste, une part considérable de la droite traditionnelle et de la social-démocratie s’applique à faire de la communauté juive une caution aux politiques qu’ils mènent, montrant un philosémitisme de façade cachant un antisémitisme de fond. Ainsi, face au renoncement de la gauche radicale, les « partis de gouvernement » s’emploient à combler le vide en procédant, dans un schéma purement hérité du colonialisme, à opposer la « communauté juive modèle et assimilée » aux autres communautés issues de l’immigration post-coloniale, particulièrement les communautés subsahariennes et arabo-berbères du Maghreb. Il en va sans dire que cette « zone tampon » où se retrouve la communauté juive s’accompagne in facto de multiples turbulences : par un brillant tour de passe-passe non dénué de fourberie, les classes dominantes occidentales qui ont longtemps afficher une franche hostilité vis-à-vis de la communauté juive se présentent ironiquement comme ses sauveurs en même temps qu’ils nourrissent, par cette attitude hypocrite même, le cliché antisémite du « privilège juif ». Face à cette situation difficilement tenable, la communauté juive se retrouve coincée entre deux feux. Indexée, brutalisée ou instrumentalisée, elle ne sait où donner de la tête.
- Une autre position, le plus souvent comprise dans les deux premières, a pour finalité la dilution du « concept de juif » en même temps qu’elle s’y réfère : elle aboutit donc invariablement à l’échec. Son caractère « humaniste abstrait » qui consiste à ne reconnaitre le juif qu’en dehors de sa judéité, donc uniquement et paradoxalement que lorsqu’il s’extirpe de sa condition juive, la rend inopérante et l’astreint à une pure profession de foi humaniste. Deux raisons y convergent : la première tient du fait que dans cette idée toute hégélienne qui n’accepte le juif que lorsqu’il a « tuer le juif en lui », c’est-à-dire lorsqu’il revêt les apparences d’un goy et se vit comme tel, lorsqu’il se « libère » des chaines de son particularisme pour s’ouvrir à l’universel (occidental) s’affiche une ignorance complète des mécanismes antisémites à l’œuvre, de leur logique intrinsèque qui reconnait justement la « juiverie » du juif dans sa volonté de dissimulation. « Le juif n’est pas aimé à partir du moment où il est dépisté » écrit Franz Fanon ; et cette nécessité de « dépister » le juif, tel un silencieux virus dévorant sourdement l’organisme social rajoute à sa fourberie, à son caractère irrémédiablement malin et trompeur. Pile je gagne face tu perds : qu’il arbore sa judéité ou qu’il l’occulte, le juif finit indistinctement sur le banc des accusés, coupable d’en faire trop ou pas assez.
Conclusion synthétique
Pour conclure cette brève étude qui saura, je l’espère, faire son chemin et impulser une campagne de rectification au sein des divers milieux révolutionnaires en permettant aux militants honnêtes et sincères de prendre conscience des mécanismes discriminatoires et oppressifs décrits tout au long de cet article-fleuve ; d’abord pour lutter efficacement contre le fléau antisémite contemporain, mais aussi, dans une démarche fraternelle et fidèle aux meilleurs traditions communistes, d’amorcer une autocritique collective au sein même des rangs révolutionnaires, je voudrais retranscrire les mots justes de Léon Pinsker rappelant avec une mordante ironie l’affreuse mécanique de la bêtise antisémite : « Le Juif est considéré par les vivants comme un mort, par les autochtones comme un étranger, par les indigènes sédentaires comme un clochard, par les gens aisés comme un mendiant, par les pauvres gens comme un exploiteur millionnaire, par les patriotes comme un apatride, et par toutes les classes comme un concurrent qu’on déteste. »