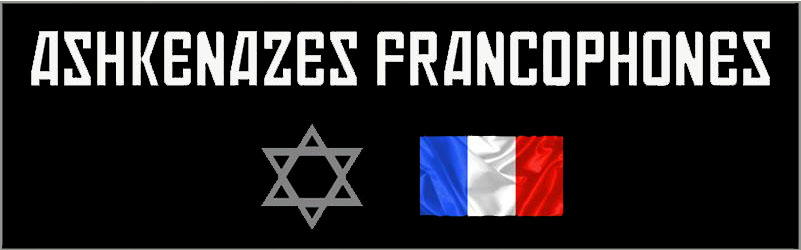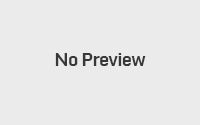Ashkénazes versus Ashkénazes
Ce n’est ni une généralité ni un cliché, mais parmi les Ashkénazes que j’ai connus, j’ai souvent remarqué deux types de parcours. D’un côté, il y a ceux qui ont grandi dans un milieu plutôt bourgeois, avec des parents issus d’un milieu populaire, mais qui ont réussi socialement et ont transmis cette réussite à leurs enfants. Souvent, ces Ashkénazes ont choisi des professions tournées vers l’aide aux autres : médecins, psychologues, chercheurs, avocats… comme si un certain sens de la justice ou du devoir social s’était perpétué.
D’un autre côté, j’ai aussi connu des personnes qui, malgré leur éducation bourgeoise, ont ressenti le besoin de se confronter à la marginalité. Leur mode de vie était parfois dissolu, subversif, voire risqué, mais ce n’était pas une simple forme d’autodestruction ou de régression. Je pense qu’ils cherchaient, d’une certaine manière, à renouer avec leurs origines, à retrouver une forme de dureté et d’adversité, comme s’ils voulaient revivre, à leur manière, le combat de leurs aïeux pour mieux s’en sortir.