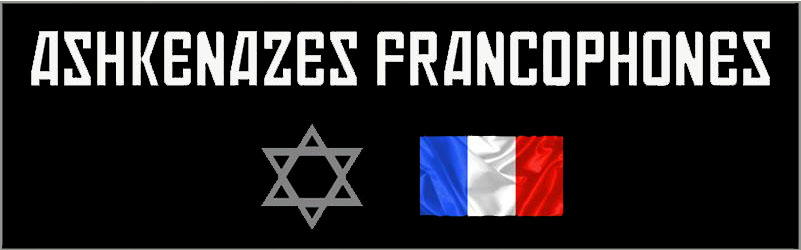Les groupes d’autodéfense juifs en Europe de l’Est
À la fin du XIXᵉ siècle et au début du XXᵉ, les communautés juives d’Europe de l’Est vivaient sous la menace constante des pogroms – attaques collectives, souvent organisées ou tolérées par les autorités locales, qui détruisaient des maisons, des commerces, et parfois coûtaient la vie à des familles entières.
Face à ces violences répétées, des jeunes Juifs décidèrent de ne plus subir passivement. Dans des villes comme Odessa, Kiev, Minsk ou Varsovie, naquirent des groupes d’autodéfense juifs. Ces formations étaient souvent composées d’ouvriers, d’étudiants, ou de membres de partis socialistes et sionistes. Armés de bâtons, de revolvers récupérés ou même d’outils de travail, ils s’organisaient pour protéger les quartiers juifs lors des rumeurs d’attaques.
Leur rôle n’était pas d’attaquer, mais de dissuader. Le simple fait que des Juifs se tiennent en groupes, prêts à se défendre, changeait le rapport de force : les agresseurs comprenaient qu’ils ne s’en prendraient plus à des victimes sans défense.
Ces milices improvisées furent un symbole de résistance et de dignité. Elles inspirèrent plus tard les mouvements de résistance juive pendant la Shoah, notamment lors du soulèvement du ghetto de Varsovie en 1943.
Aujourd’hui encore, leur mémoire rappelle que l’autodéfense n’est pas une glorification de la violence, mais un acte de survie et de courage face à la haine.